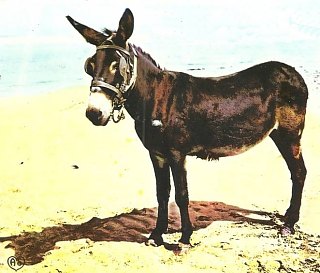|
|
|||||
|
L’appétit vient en mangeant Plus on a, plus on veut avoir Ce proverbe dont l’origine remonterait au XVIe siècle ne s’applique guère que dans un sens direct, car manger a pour effet de diminuer l’appétit, mais il s’adresse plutôt indirectement aux riches avides qui n’ont jamais assez et qui, loin d’être satisfaits de posséder tout ce qu’ils désirent n’en sont que plus excités à désirer davantage. Il peut s’appliquer également par métaphore aux voleurs qui s’habituent facilement à voler et y prennent un goût de plus en plus vif ou à tous ces importuns qui fatiguent leurs amis par des demandes incessantes. On pense que cette expression, rapportée par Rabelais (XVIe siècle), dans le cinquième chapitre de Gargantua, aurait été employée par l’abbé Amyot, le traducteur de Plutarque, dans la réponse qu’il fit à Charles IX dont il avait été le précepteur, un jour que ce prince lui manifestait sa surprise de voir qu’ayant paru d’abord satisfait de sa position modeste, il postulait la possession du riche évêché d’Auxerre. Les auteurs anciens avaient comparé à la faim le désir qui croit d’intensité en se satisfaisant. Ainsi les Latins disaient-ils : Mendicorum loculi semper inanes, ce qui signifie : La besace des mendiants n’est jamais pleine. Ovide, dans ses Métamorphoses (livre III, fable 11), avait dit en parlant d’Erisichthon condamné par la déesse Cérès à une faim dévorante et continuelle :
mots qui se traduisent par ceux-ci : Tout aliment qu’il absorbe excite en lui le besoin d’un autre aliment. Le même poète a dit dans un autre endroit : Quo plus sunt potae, plus sitiuntur aquae, ce qui signifie : Plus on boit, plus on est altéré. On retrouve chez l’historien Quinte-Curce (livre VII, chapitre 8), cette phrase dans le discours des Scythes à Alexandre : Primus omnium, satietate parasti famem, ce qui veut dire : Tu es le premier chez qui la satiété ait engendré la faim. Ce proverbe répond à un autre proverbe des Anciens : Dulce pomum quum abest custos, ce qui veut dire : Doux fruit quand le gardien est absent. Ovide nous a laissé ce vers sur ce sujet : Nitimur in vetitum semper cupimusque negata, ce qui signifie : Nous tendons toujours vers ce qui est défendu et ne désirons que ce qu’on nous refuse. Les Hébreux possédaient ce proverbe : Aquar furlivae dulciores sunt et panis absconditus suavior, ce qui veut dire : Les eaux dérobées sont plus douces et le pain pris en cachette plus agréable. Citons pour terminer ces deux vers de La Fontaine :
Pain dérobé que l’on mange en cachette De toutes ces citations on peut conclure que la cupidité et l’ambition, poussées à l’extrême, rendent odieux ceux qui en sont possédés, parce que ce sont des sentiments égoïstes et que, pour y satisfaire, on n’hésite pas souvent à fouler aux pieds toute dignité humaine et à sacrifier presque toujours les droits d’autrui.
Ménager la chèvre et le chou C’est parer à deux inconvénients et ménager des intérêts opposés ; c’est en un mot, prendre parti tantôt pour l’un tantôt pour l’autre, de façon à se trouver en faveur auprès de celui qui l’emportera Cette locution proverbiale nous est venue du problème suivant que l’on donnait à résoudre aux enfants pour les accoutumer à réfléchir et à exercer leur sagacité. Voici en quoi consistait ce problème. « Un homme veut traverser un cours d’eau ; il a avec lui une chèvre, un chou et un loup. Ne pouvant les passer tous ensemble à cause de l’exiguïté de son bateau, et ne voulant pas laisser la chèvre avec le chou, de peur que l’une ne mangeât l’autre ou le loup avec la chèvre dans la crainte que celle-ci ne fût mangée par le premier, ce qu’il s’agissait d’éviter, voici comment il s’y prit pour arriver à une solution : « Il passa la chèvre en premier, persuadé qu’il n’y avait aucun danger à laisser le chou avec le loup. Après avoir déposé la chèvre sur l’autre bord, il revint chercher le loup et le chou, de cette façon la chèvre ne mangea pas le chou et le loup ne mangea pas la chèvre. » Cette locution s’emploie toujours en mauvaise part. Les personnes qui ménagent la chèvre et le chou sont intéressées ou ambitieuses. Il faut avoir le courage de son opinion et approuver ou désapprouver la conduite des autres, sans critiquer pour cela ostensiblement tout ce qui n’est pas conforme à son opinion. Agir autrement, c’est se rendre coupable d’hypocrisie, car on ne doit pas feindre d’applaudir des actes que l’on condamne et paraître estimer des gens qu’on méprise. En 1807, un M. Tournay fit de ce proverbe le sujet d’une chanson, sur l’air du Ballet des Pierrots ; en voici le premier couplet :
Mettre la charrue Il ne faut pas commencer par ce qui doit être la fin Ce proverbe s’emploie pour critiquer tout individu qui, étourdiment et sans avoir réfléchi, veut faire d’abord un acte qui ne devrait venir qu’après un autre. De là, la comparaison de la charrue à laquelle doivent être attelés les bœufs, car on regarderait comme fou le laboureur qui les placerait dans le sens contraire. L’idée, émise par ce proverbe, est donc qu’il ne faut pas intervertir l’ordre naturel des choses et des affaires. Savoir bien disposer ce que l’on veut faire est une véritable science qui n’appartient qu’aux bons esprits. Si des écoliers veulent en remontrer à leurs maîtres ou Gros-Jean à son curé, comme dit La Fontaine, si des soldats veulent imposer leurs volontés à leurs chefs, c’est mettre la charrue devant les bœufs. Voici des vers sur ce sujet tirés du roman de Tristan qui date du XIIIe siècle :
(Ce serait certes une grande faute de faire aller le char devant le bœuf).
|
|||||
|
Il ne faut pas mettre le doigt Ne pas intervenir dans les querelles de personnes, en apparence bien unies. Le motif qui fait que deux personnes se disputent momentanément ne peut durer, le différend n’étant que passager, si celles-ci sont, en général, bien unies. Divisées par des circonstances fortuites, elles doivent se rapprocher évidemment, au détriment d’un conciliateur indiscret.
Dans sa pièce du Médecin malgré lui, Molière (1666) met en scène un personnage qui croit devoir Intervenir dans une querelle entre un mari et sa femme. Mal lui en prend, parce que c’est sur lui que tombent les coups du ménage réconcilié. Voici les paroles que l’auteur fait dire à Sganarelle : « Vous êtes un impertinent de vous ingérer dans les affaires d’autrui. Apprenez que Cicéron dit : Qu’entre l’arbre et l’écorce il ne faut pas mettre le doigt. » Ce conseil s^adresse aux gens qui aiment à se mêler de tout et même souvent beaucoup moins de leurs affaires que de celles des autres. Il s’applique aussi aux imprudents qui veulent intervenir dans les querelles de ménage et qui ne font que se rendre désagréables aux deux parties. Un proverbe turc dit : Ne te mets pas entre l’ongle et la chair. L’origine de ce proverbe est tirée probablement de l’anecdote suivante qui est puisée dans l’histoire ancienne. « Milon de Crotone était un athlète fort célèbre par sa force extraordinaire. Quoiqu’il eût cessé depuis longtemps déjà de concourir dans les jeux publics, il voulut, un jour, bien qu’il eût atteint un âge avancé, éprouver s’il lui restait encore quelque force. Il traversait tout seul une forêt ; près de sa route se trouvait un chêne fendu déjà de plusieurs côtés. Il mit ses doigts dans les fentes et essaya de séparer l’arbre en deux parties. « Il commença bien à écarter les fentes jusqu’au centre et se reposa un moment de ses efforts tout en laissant ses mains dans l’ouverture. Mais, sans qu’il s’en doutât, les deux parties de l’arbre se rejoignirent et retinrent si fortement les mains de l’athlète, qu’il ne put se dégager. Les bêtes féroces de la forêt le mirent en pièces. »
Disputer sur la pointe C’est se quereller ou se disputer pour une chose qui n’en vaut pas la peine ou bien encore discuter sur des futilités Ce proverbe a eu une autre forme que celle que nous possédons actuellement. Il a dû provenir du proverbe grec que voici : Disputer sur l’ombre d’un âne, qui avait été tiré d’une histoire que le grand orateur Démosthène conta, dit-on, aux Athéniens, pour les rendre un peu plus attentifs aux discours qu’il leur faisait en faveur d’un homme qu’il voulait arracher au supplice.
« Un jeune homme, disait-il, avait loué un âne pour aller d’Athènes à Mégare. C’était dans l’été, vers l’heure de midi ; le soleil était brûlant. Notre voyageur, ne sachant comment faire pour se mettre à l’abri de la chaleur, descend de sa monture, s’assied près d’elle et se repose à son ombre. Mais le propriétaire de l’âne qui voyageait avec ce jeune homme, prétend que cette place lui appartient, en disant qu’il avait bien loué l’âne, mais non son ombre. La dispute s’échauffe et des paroles on en vient aux coups, si bien que cette affaire futile en apparence dans le fond resta, malgré les violences, sans solution satisfaisante et qu’elle fut même portée en justice. » Après avoir ainsi parlé, Démosthène allait reprendre sa harangue ; mais ses auditeurs, piqués par la curiosité, voulurent connaître qu’elle avait été la décision des juges dans cette affaire. Le grand orateur releva cette puérilité en leur reprochant d’accorder plus d’attention à une dispute provenant de l’ombre d’un âne qu’à une cause où il s’agissait de la vie et de l’honneur d’un homme. Donc, disputer sur l’ombre d’un âne ou disputer sur la pointe d’une aiguille sont identiques quant à l’objet, puisque l’ombre d’un âne, comme n’importe quelle ombre, est une chose insaisissable, et que la pointe d’une aiguille est la plus petite dimension qu’on puisse concevoir. Finalement, dans l’un et l’autre cas, c’est disputer sur des riens. Les Latins disaient : Rixari de lana caprina, ce qui veut dire : Disputer sur la laine d’une chèvre, expression qui se retrouve dans ce vers d’Horace : Alter rixatur de lana saepe caprina. On trouve dans le poète Régnier (XVIe) ces deux vers :
Les Allemands disent : Disputer sur la barbe de l’empereur.
Les battus paient l’amende Les plus faibles passent pour coupables et sont punis Au Moyen Age on faisait combattre ensemble deux champions qui avaient entre eux un différend. La législation de celte époque permettait au juge de remettre la solution d’une affaire au sort des armes. Celui-ci prononçait qu’il échéait gage de bataille et les deux parties après avoir entendu une messe dite pour la circonstance, messa pro duello, allaient, sous les yeux des magistrats, plaider leur cause, en champ clos. Les nobles, armés de pied en cap, combattaient à cheval, les vilains ou paysans à pied et armés seulement d’un bâton et d’un bouclier. La victoire était la preuve du droit, comme le combat en était la discussion, parce que Ion croyait que Dieu ayant été pris pour juge, devait toujours faire triompher celui qui avait raison. C’était vers le VIIIe siècle. Plus le sujet était grave, plus on faisait jurer de personnes avec l’accusé. C’est ce qu’on appelait jurare tertia manu, septima, duodecima, etc., ce qui voulait dire jurer par trois, sept, douze mains selon le nombre de ceux qui juraient avec l’accusé et qui devaient être surtout de sa condition. Ainsi, un noble faisait jurer des nobles, un prêtre des prêtres et une femme faisait jurer des femmes. L’accusé prononçait seul la formule de son serment et ceux qui juraient avec lui disaient seulement : Je crois qu’il dit vrai. Quand les uns attestaient un fait que les autres niaient, on choisissait un champion de chaque côté pour se battre ; le vaincu, réputé parjure, avait la main coupée, les autres témoins payaient l’amende, pour racheter leur main. Dans un vieux titré de l’an 1448, il est écrit que le pleige (celui qui portait la caution), était obligé de payer pour le vaincu 112 sols d’amende. Voici trois vers extraits d’un fabliau manuscrit qui ont trait à ce sujet :
qui veut dire : C’est la coutume du vaincu de jeter au milieu du champ par peur son bâton et son bouclier. Quoi qu’il en soit, il est certain qu’au Moyen Age on disait avoir la coustume au vaincu, pour être condamné, en ayant toutefois le droit de se plaindre d’être battu convenablement et de payer l’amende. Quand les contestations reposaient sur des matières criminelles, le vaincu seul, s’il ne succombait pas sous l’arme de son adversaire, était livré au bourreau pour avoir la main coupée, ainsi qu’il a été dit plus haut.
Lorsque, au contraire, elles appartenaient à des matières civiles, le
vaincu n’était pas mis à mort, mais lui et les témoins qui avaient pris
son parti se rachetaient de la peine encourue par la défaite en payant
une amende plus ou moins forte comme satisfaction au vainqueur, de là le
proverbe : Les battus paient l’amende.
|
|||||
|
Briller par son absence Locution employée pour désigner toute personne dont l’absence est facilement remarquée On se sert aussi de ces mots comme d’une plaisanterie. Voici l’origine que l’on a donné à cette locution proverbiale : « Un parent du ministre Colbert, alors intendant des galères de Marseille, avait réuni les portraits d’une centaine de personnages célèbres du XVIIe siècle.
Comme son désir était de les faire graver, il pria Charles Perrault, l’auteur des contes, de rédiger des notices qui devaient accompagner chacun de ces portraits. Celui-ci accepta volontiers la tâche et fit paraître en 1696, à Paris, un ouvrage en deux volumes, intitulé : Les éloges des hommes illustres du XVIIe siècle. « Mais les jésuites virent d’un mauvais œil que les noms d’Arnault et de Pascal, qu’ils réprouvaient, fussent placés dans cette galerie et ils obtinrent qu’on supprimât ces deux noms. Cependant, comme depuis longtemps, le public se montrait beaucoup plus favorable à la cause des habitants de Port-Royal, on se moqua des jésuites en leur appliquant la fameuse phrase de Tacite prononcée à l’occasion des funérailles de Junie (Annales, livre III, chapitre 37) : Praefulgebant Cassius atque Brutus, eo ipso effigies eorum non videbantur, ce qui signifie : Cassius et Brutus y brillaient d’autant mieux que leurs images étaient absentes.
Avaler la pilule C’est faire par nécessité une chose qui même ne fait que contrarier, ou bien encore c’est recevoir un affront sans mot dire Il existe un proverbe latin qui se rapporte au dicton français : Pilulae sunt glutiendae, non manducandae, qui veut dire : Les pilules sont pour être avalées, non mangées, ce qui signifie : Qu’il faut oublier les injures. De même que les pilules sont désagréables au goût, quand on se met à les mâcher, et qu’elles font du bien à l’estomac, (si on ne fait que les avaler), ainsi en est-il de même des injures. Pour qu’elles n’aient rien de mordant (ut nihil habeant quod mordeat), on doit les dévorer en silence sans se laisser arrêter par les souvenirs. Molière (XVIIe siècle) disait : Que le mépris est une pilule que l’on pouvait bien avaler, mais qu’on ne pouvait guère mâcher sans faire la grimace.
|
|||||